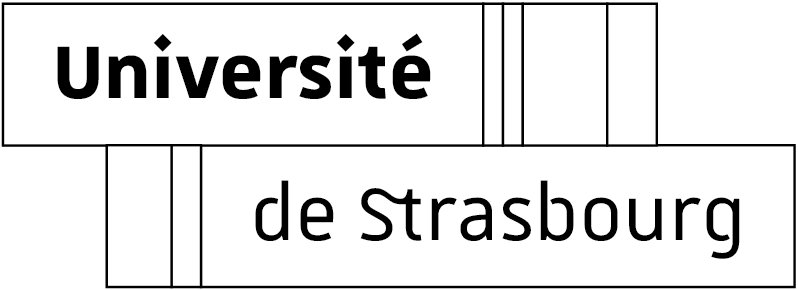Centre du Parc
Face au Nouveau Patio
67000 Strasbourg
Installation sonore, 8 canaux de diffusion audio, 3 à 60 min, en boucle
Avec
Jean Pierre Bucher, chercheur_IPCMS
Nicolas Busser, chargé de communication et photographe_IPHC
Ovidiu Ersen, chercheur_IPCMS
Barbara Gollain, chargée de collection_EOST & Jardin des Sciences
Delphine Issenmann, responsable du pôle musées, collections et patrimoine_Jardin des Sciences
Paul Montgomery, chercheur_Laboratoire ICube
Marc Schmutz, chercheur_ICS
Pierre Van Hove, chercheur_IPHC
Les voix de chercheurs et chargés de collection résonnent autour de nous. Depuis les arbres, elles nous arrivent fragmentées, fragiles. Ces voix évoquent le rapport du scientifique à l’image, la véracité de ces images, leur conservation, leur réception dans la société, la possible distorsion de leur message…
Cette pièce sonore est liée à un ensemble de 4 œuvres qui évoquent chacune la question de l’image d’archive, le lien entretenu avec celui qui la crée ou celui qui la conserve, les processus de transmission et d’interprétation qui les sous-tendent.
La collaboration avec Olivier Crouzel vue par Jean-Pierre Bucher
Olivier Crouzel, a débarqué un jour au labo avec son matériel d’enregistrement. Je me suis immédiatement senti en confiance. Il donne la parole au chercheur. C’est ce lien qu’il établit entre l’humain et ses réalisations qui m’a d’emblée séduit.
Est-ce que j’ai des archives ? Je lui réponds qu’en recherche fondamentale les archives ce n’est pas vraiment un sujet. Comme beaucoup de mes collègues, je considère que l’aboutissement d’une recherche, c’est une publication ou pour la transmission, un exposé à une conférence internationale. Une fois l’article publié, on passe à autre chose. Les images numérisées, comme tout le reste, ne sont que des données sur un disque dur, on en perd un peu à chaque changement d’ordinateur ou de lieu de travail.
Au fil de la conversation et des questions, il insiste et pointe mon armoire à dossiers. J’ouvre un tiroir, je prends un dossier dont j’étale le contenu sur mon bureau. Et là, surprise, je redécouvre mes propres travaux dont certains remontent à ma thèse de doctorat quand le « power point » n’existait pas encore. On a regardé les transparents que je venais d’exhumer sur une table lumineuse qu’il avait apportée. Pendant que j’expliquais, il photographiait et enregistrait. Le temps que la mémoire se réactive, ce sont toutes les situations passées qui refont surface comme l’image latente de la photographie qui ne demande qu’à être développée.
Bien sûr que je suis sensible à l’esthétique de l’image. En même temps, pour moi ce ne sont pas juste des images c’est de l’information codée. Je sais, par exemple, que telle image est obtenue à partir du signal d’une pointe qui enregistre un courant tunnel d’électrons. Les objets que l’on visualise de cette manière sont alors tellement petits qu’il n’y a plus vraiment de sens à vouloir parler de la trajectoire d’un électron, c’est Heisenberg qui nous l’apprend. En fait, à partir des mesures instrumentales, on ne fait que représenter une fonction d’onde électronique.
Et puis, on réfléchit et on se demande ce qui fait qu’on choisit telle image plutôt que telle autre. Il y a le critère scientifique, mais pas seulement. En recherche, on n’est pas toujours sûr de trouver et il y a une bonne part de sérendipité. La science expérimentale n’est pas une démarche linéaire, il y a des nœuds et des bifurcations. Qu’est-ce qui fait alors qu’on privilégie une piste plutôt qu’une autre ?
Je pense à cette masse de données, à toutes ces informations qui s’accumulent dans les mémoires de nos ordinateurs, ne seraient-elles dues qu’au hasard ? J’ai mon idée là-dessus. Je crois qu’en recherche comme en littérature on doit pouvoir raconter une histoire alors même qu’un évènement anodin est venu tout chambouler. C’est le cas aussi dans la vraie vie, ça a été très bien montré au cinéma par Alain Resnais dans Smoking/No Smoking ou dans certains films d’Eric Rohmer. Est-ce à dire que tout ce qui ne rentre pas dans l’histoire est perdu ? Qui se préoccupe des chutes ?
Les réalisations de Olivier Crouzel racontent une histoire et ses vidéoprojections nocturnes ont la même poésie que les séances de lanterne magique de nos aïeux le soir à la veillée. En me plongeant dans ses réalisations, c’est son approche humaniste qui me touche le plus.
La collaboration avec Olivier Crouzel vue par Ovidiu Ersen
« Plongée dans le nanomonde »
Lors de ses explorations, Olivier Crouzel a cette fois jeté son dévolu sur l’univers de l’infiniment petit. Les microscopistes disent, sans y penser, qu’ils « voient » les nanoparticules, ces objets qui sont dix millions de fois plus petits qu’une mouche. Non, ce qu’ils voient ce sont des courbes sur des écrans, des taches grises sur fond gris, dans le meilleur des cas. Un microscope électronique délivre des signaux électriques complètement incompréhensibles pour l’homme ; il y a entre la machine et cet homme un ensemble complexe de dispositifs électroniques, d’ordinateurs sophistiqués, bourrés de logiciels concentrant de très fortes doses d’intelligence humaine. Et ce n’est qu’après que les signaux électriques aient été digérés qu’ils deviennent compréhensibles, mieux qu’ils donnent à « voir » les infiniment petits.
Déterminé à confronter sa vision du monde avec cette « vision » électronique, Olivier Crouzel s’est rendu dans notre institut pour rencontrer ces gens qui disent explorer l’infiniment petit. Nous lui avons présenté les images de nanoparticules, au contraste parcimonieux, les mêmes que vous pouvez voir dans les œuvres d’Olivier.
Pour voir les nanoparticules, il faut encore apprendre à lire toutes ces images. Olivier Crouzel a écouté, étonné, notre discours. « Voyez ces images, elles montrent des atomes de carbone qui se lient, les uns aux autres de telle sorte qu’ils forment un tout petit, petit, tube que l’on regarde croître telle une plante extraterrestre. Nous observons ce qui se passe dans une toute petite cellule de quelques millimètres placée dans le microscope, nous y envoyons du gaz carbonique qui se décompose et les atomes de carbone libérés s’ordonnent entre eux pour faire ces objets inattendus. Et là regardez en temps réel, c’est encore mieux. On est toujours dans le monde des atomes de carbone, à la surface d’un cristal de graphite aux atomes rangés en nid d’abeilles. Ce qui a l’air d’être d’étranges véhicules se déplaçant au hasard sont en réalité de très petits cristaux de fer qui se déplacent suivant les lignes de symétrie de la surface. Le plus petit moteur atomique à gaz a été ainsi découvert. Lorsqu’on injecte de l’hydrogène, les atomes de fer posés sur le graphite se mettent en mouvement, ils avalent par l’avant des atomes d’hydrogène et relâchent à l’arrière du méthane produit de la réaction entre carbone et hydrogène. »
Nous avons eu l’impression qu’Olivier Crouzel est sorti émerveillé de cette nouvelle exploration, il a compris que comme l’art, la recherche est d’abord un discours. Maintenant nous sommes impatients de connaître le discours qu’il tiendra et qui transformera les images de la recherche en images artistiques.
La collaboration avec Olivier Crouzel vue par Delphine Issenmann
L’étude et la préservation du patrimoine universitaire, qui forment le cœur de ma mission, n’ont de sens que si elles permettent de rendre ce dernier accessible. La collaboration avec les artistes participe à cette ouverture. La rencontre avec Olivier Crouzel était l’occasion de faire dialoguer nos curiosités respectives vis-à-vis d’un fonds qui est loin d’avoir livré tous ses secrets.
De mon côté, j’aborde l’image d’archive par étapes : la première est évidemment visuelle – c’est avant tout une image que j’apprécie pour sa dimension esthétique ; ensuite vient la question du sens, du message qui parfois m’échappe ou n’est délivré qu’à l’issue d’une investigation plus poussée : l’image devient alors document ; enfin, se pose la question de la préservation et du partage de l’image en tant qu’objet patrimonial, un enjeu aussi déterminant pour une plaque de verre que pour un fichier numérique !
La collaboration avec Olivier Crouzel vue par Paul Montgomery
Ma rencontre avec Olivier Crouzel fut pour moi un voyage nostalgique, dans mon histoire de chercheur, dans mon monde de la recherche expérimentale, dans mes paysages en microscopie optique et en interférométrie en sciences des matériaux. En regardant mes images numériques sur mon PC portable en 2020 et des vieilles photos et diapositives argentiques des années 1980, je fus submergé par l’émotion. Convictions et questionnements refirent surface. Je me rappelais de mon premier résultat de mesure en 3D en microscopie à saut de phase en 1989, étonné de voir que l’équation mathématique fonctionnait correctement et donnait une mesure 3D à partir de trois « simples » images du microscope. Je n’étais pas le premier à l’avoir fait, mais je « voyais » le relief nanométrique grâce à mon propre système dont l’élément essentiel avait été conçu pour quelques francs. Malgré les limites fondamentales de l’optique, malgré les artefacts présents dans les images, malgré les ordinateurs rudimentaires en comparaison des PC d’aujourd’hui, on arrivait à observer des reliefs et des défauts dans le domaine naissant de la « nanoscopie », à voir l’invisible et ainsi à contribuer à l’amélioration des matériaux qui ont permis la révolution numérique.
Ces anciens résultats renforcent davantage encore mes convictions que la science nous permet de mieux comprendre la nature autour de nous. La science peut nous apporter également quelques réponses aux grandes questions sur l’énergie, sur l’environnement et sur la santé qui sont les thèmes phares du laboratoire ICube dont je fais partie.
Pourtant, je suis amené à me poser de nombreuses questions parce que je suis convaincu que la science a des limites ; elle ne peut pas tout faire. Le numérique fait partie de ma vie de scientifique : en m’aidant à aller plus loin dans l’instrumentation optique, en permettant des mesures 3D en temps réel, la mesure de plusieurs paramètres en même temps et en permettant une vision de structures plus petites par la « super-résolution » à l’aide de microsphères de verre.
Aujourd’hui les microscopes sont souvent dépourvus d’oculaires. Nous sommes donc dépendants de l’acquisition et du traitement numérique pour l’image finale. Si je ne peux plus « voir » directement les défauts dans un matériau, comment puis-je être sûr de ce que je vois ? Voilà toute l’importance de se poser des questions en continu sur la théorie, sur la chaîne d’acquisition et de traitement de l’information et au final sur le rôle vital joué par l’étape de calibration du système et la mesure d’objets calibrés. Se mettre en question tout le temps, augmenter les certitudes sur ce qu’on sait et de ce qu’on ne sait pas est un vrai travail, nécessaire pour un chercheur.
La collaboration avec Olivier Crouzel vue par Marc Schmutz
La microscopie électronique génère beaucoup d’images.
La tradition chez les microscopistes est de conserver les négatifs pendant de (très) nombreuses années. En effet, il nous arrive de temps en temps de revenir sur des résultats obtenus dans le temps au regard de nouvelles données publiées. Ainsi nous utilisons nos anciennes images parfois inexpliquées ou seulement partiellement comprises pour avancer dans la compréhension de divers phénomènes. La rencontre avec Olivier Crouzel m’a fait me replonger dans mes archives, est permis de me rendre compte du chemin parcouru sur la compréhension des sujets étudiés dans le temps. D’autre part le regard croisé des images entre Olivier et moi-même m’a fait apparaitre bien d’autres choses dans mes images, là où il y avait surtout de la science, un côté plus mystérieux et transmuté pouvait émerger.
La collaboration avec Olivier Crouzel vue par Pierre Van Hove
En 2020, j’ai ouvert ma porte à un artiste, Olivier Crouzel, qui se proposait de réaliser une œuvre à partir d’images d’archives de la recherche et de discussions avec des chercheurs. Une proposition suffisamment ouverte pour qu’elle attise ma curiosité…
Concrètement, pendant quelques heures, nous avons mené une discussion échevelée sur mon métier, la recherche en physique des particules, ses théories sous-jacentes, son rapport à l’image, et des réflexions philosophiques diverses. Puis, dans les jours qui ont suivi, nous avons échangé sur les données de l’expérience sur laquelle je travaille et que l’artiste pensait utiliser.
Ensuite, plus de nouvelles… Était-il découragé par tant de discussions abstraites, bien éloignées des images concrètes de son art ? Qu’allait-il faire des données qu’il m’avait demandées et que je jugeais complètement inutilisables sans les logiciels d’analyse dédiés ?
Le temps a passé, et j’apprends alors que l’œuvre d’Olivier comporte une pièce sonore : « voix de chercheurs évoquant leur rapport aux archives, à la recherche ». Surprise totale : où est passée l’image ?
Quelques explications plus tard, j’adhère complètement à l’idée. Par un subtil « pas de côté » lui permettant d’éviter l’explicite, Olivier rend sensible un certain rapport à la recherche, à l’image, à l’importance de légender, d’archiver et à l’inconnu qui se dresse devant nous lorsque l’image et sa légende sont déconnectées.
Le projet vu par Olivier Crouzel
J’ai rencontré cinq chercheurs de l’Université de Strasbourg, des physiciens qui observent des particules élémentaires, des interférences microscopiques, des déplacements de molécules, des nanotubes, des gels… Au musée de minéralogie, j’ai découvert des cristaux issus des plus grands cataclysmes terrestres, des météorites, et des photographies sur plaque de verre d’expéditions scientifiques du début du siècle dernier, l’Himalaya, le Spitzberg, la mine de Kimberley en Afrique du Sud… Le Jardin des sciences m’a proposé d’explorer le contenu de trois cartons datant de l’occupation nazie pendant la seconde guerre mondiale, des images que l’on ne montre pas mais qu’il faut garder. J’ai rencontré un chargé de communication responsable du fonds d’archives photographiques de l’Université.
J’ai enregistré nos conversations et filmé en direct les archives que l’on me proposait, les premières images, celles des découvertes, des photographies sans index et parfois des portraits sans nom. Des diapositives, des transparents, des plaques de verres cassées et des projections powerpoint constituent ce corpus iconographique de départ.
Je posais alors des questions : Avez-vous des archives dans vos tiroirs ? Montrez-moi vos premières images… Décrivez-les… À quoi servent ces images ? Que deviennent-elles ?
Je m’interrogeais : À quel moment une archive n’en est plus une ? Comment, quand on ne comprend pas une image, suggérer un désir d’interprétation, voire de compréhension ?
Alors j’ai effacé les indices, j’ai recadré, j’ai comparé, j’ai filmé les mains qui expliquent les atomes et montrent les montagnes, les visages sans nom et les particules élémentaires, j’ai mélangé les conversations.